
Comme promis, continuons dans notre série des critiques de Films qui me tiennent à coeur, et aujourd’hui nous parlerons musique, avec en exclusivité mon groupe préféré de tous les temps : Pink Floyd.
Pink Floyd est un groupe de rock progressif britannique fondé entre 1965 et 1968, avec Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason, Rick Wright, et plus tard David Gilmour, qui reprendra la guitare après le départ de Syd pour cause d’hallucinations. Débutant sur la scène psychédélique, avec des albums tels que The Piper at the Gates of Dawn (1967), le son du groupe va lentement s’orienter vers le progressif. Qu’est-ce que le rock progressif ? Des expérimentations, des mélanges d’instrumentations, des albums-concepts, des morceaux de vingt minutes quelques fois découpés en plusieurs parties, et toute une génération d’artistes voguant sur cette mouvance, avec entre autres King Crimson, Yes et The Alan Parsons Project. Toute la musique que j’aime. Pink Floyd obtient rapidement une certaine notoriété, remarqué pour ses expérimentations, sa musique si particulière et ses concerts dantesques mêlant jeux de lumières et effets spéciaux. Bien entendu, l’apogée du groupe arrive avec The Dark Side of the Moon (1973), concentré de rock progressif dans toute sa splendeur, et qui reste pour moi le meilleur album musical de tous les temps.

Il pourrait sembler étrange de parler d’un groupe de rock sur un blog traitant du cinéma, mais il y a une logique derrière tout ça. En effet, Pink Floyd a plusieurs fois posé le pied dans le septième art, en signant par exemple les bandes-originales de deux films de Barbet Schroeder, More (1969) et La Vallée (1972) (la musique de ce dernier étant commercialisée sous le nom de Obscured by Clouds, un petit bijou oublié), et en participant à la musique de Zabriskie Point (1970), réalisé par le grand Michelangelo Antonioni (même si les sessions n’auront pas été très fructueuses, elle auront eu le mérite de faire naître une ébauche de la chanson Us and Them présente sur le Dark Side of the Moon)
Mais la carrière de Pink Floyd est longue et dense, et comporte plusieurs phases. Après le « digne successeur du Dark Side » Wish You Were Here (1975), éthéré et atmosphérique, puis son alter ego froid et industriel Animals (1977), le bassiste et leader Roger Waters se lance dans un projet titanesque : un concept, c’est-à-dire une histoire ou une thématique (une pratique très courante dans le prog), s’étendant sur un double-album, une série de concerts gigantesques, et un long-métrage. The Wall débarque chez les disquaires en 1979, devenant l’un des double-albums les plus vendus de tous les temps, et une des oeuvres les plus célèbres du groupe. Malheureusement, c’est aussi elle qui signera la fin d’une époque, Roger Waters estimant que la force créatrice de Pink Floyd a disparu et qu’il lui faut démarrer une carrière solo. Mais je m’égare.
C’est bien entendu le long-métrage, sorti en 1982, scénarisé par Roger Waters et réalisé par Alan Parker, qui va nous intéresser ici. Bien évidemment, en tant que fan inconditionnel du groupe, c’est le concept entier que je vais traiter. Et c’est d’ailleurs l’occasion de présenter ce cas si particulier où ce simple concept dépasse les cadres habituels de l’art et s’étend bien au-delà.
Histoire : nous suivons les pensées d’une rock star en dépression, Pink Floyd (étrange mais vrai). Il a, depuis son enfance, subi plusieurs traumatismes : la mort de son père envoyé sur le front pendant la Seconde Guerre mondiale, sa mère surprotectrice, un professeur sadique et violent (sujet de la chanson Another Brick in the Wall, encore un tube de nos jours), sa femme qui le trompe et le quitte, sans parler de sa surconsommation de drogues et la pression liée à sa carrière d’idole du rock. Chacun de ces traumatismes est une brique qui s’ajoute au Mur imaginaire qu’il se construit et qui le sépare du reste du monde et de la société. Alors qu’il doit donner un concert, l’effet conjugué des drogues et de la dépression l’amène au paroxysme de sa folie : il se prend pour un dictateur totalitariste, raciste, dont le symbole est le marteau rouge et noir. Cet acte l’amènera à reconsidérer son Mur, tout l’enjeu de l’histoire étant de savoir s’il parviendra à le détruire…

Dans l’album, chaque chanson décrit la vie et les expériences du héros, à travers un portrait sombre dans lequel Roger Waters se « met en scène » dans le rôle principal (en clair, il prête sa voix au perso). Les morceaux sont entrecoupés d’interludes parlés ou tout en bruitages (coups, sons d’une télévision ou d’un téléphone…), comme des scènes de film accentuant l’aspect histoire-concept. Au fur et à mesure que l’album avance, Pink Floyd construit son Mur, qui l’isole de plus en plus du reste des hommes, jusqu’au dernier morceau, The Trial, un bijou de composition, dans lequel le héros s’inflige un procès, qui aboutit à une condamnation sévère : il doit briser le Mur et revenir dans la société. Roger Waters y interprète d’ailleurs toutes les voix, la chanson étant construite comme une réunion de tous les personnages de l’histoire.

Pendant les concerts, de vrais défis logistiques, un mur de construit au fur et à mesure, séparant les musiciens du public. Des séquences en animations réalisées par Gerald Scarfe, malsaines et psychédéliques, accompagnent certains morceaux, dont le dernier, le procès étant totalement montré en animation, Waters chantant par dessus. Puis le Mur est détruit en fin de concert, et tout le monde est heureux.
Bien évidemment, un tel concept offrant une mise en scène aussi inventive ne pouvait qu’aboutir à un film. Le choix de Waters s’est porté sur Alan Parker, déjà connu pour Midnight Express (1978) et Fame (1980), des films excellents qui sentent bon les années 1980. Parker a une identité visuelle très marquée, à la fois chaleureuse et froide, et est un excellent choix pour adapter l’album.
La première particularité du film est de n’avoir presque aucun dialogue, ou alors des répliques çà et là. En réalité, tout le film est musical, reprenant dans les grandes lignes les chansons de l’album, avec quelques variations. Les paroles étant les pensées du personnage, la scène est explicitée à travers la musique. Mais pas seulement.

Pink Floyd (Bob Geldof) revit son enfance et sa carrière, assis dans un fauteuil et les yeux rivés devant la TV. Les souvenirs, arrivant de manière non chronologique, se mélangent avec le présent, les délires et les hallucinations. La bonne idée est d’avoir incorporé les séquences animées des concerts, apportant une touche de glauque et de folie. Ainsi, la scène du procès fantasmé est la version animée (oui, celle avec le juge qui se transforme en anus… oui… j’aime beaucoup ce film)
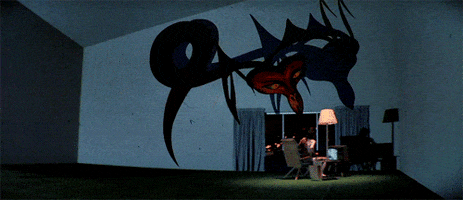
Ces séquences sont devenues plus cultes encore que le reste du film (si on excepte la révolte des écoliers, la scène étant devenue le clip de la chanson tube, et encore diffusée aujourd’hui). Elles montrent avec un style très cru et torturé les pensées du héros, à savoir des formes et figures humanoïdes se tordant, se transformant et s’auto-détruisant, dans une ambiance cauchemardesque, le tout chargé d’une forte dose de symbolisme, notamment avec la représentation de la guerre et de la violence (et le film y va à fond, attention aux âmes sensibles). Ces scènes sont de véritables plongées dans l’esprit schizophrène du personnage, et résument le concept du film : une intrusion dans la psyché erratique d’un homme asocial, au bord de la folie, dont le parcours mental s’apparente à une véritable « quête du héros », celle de la libération. Une libération nuancée et paradoxale, car c’est celle d’un isolement qui le protège d’un monde cruel et aliénant, comme nous le verrons un peu plus loin.

Le film baigne globalement dans un univers malsain et rock ‘n’ roll. On pourrait y voir une sorte de référence à Syd Barrett, fondateur de Pink Floyd, dont la chute a été provoqué par la drogue (un sujet déjà présent dans l’album Wish You Were Here). Pink, cherchant la liberté avec la musique et le spectacle, monde vertigineux et dangereux, celui de tous les excès, est dévoré par celui-ci, la drogue, le sexe et l’alcool, comme en témoigne la scène de la groupie, qui abouti à la destruction du visage de rock star du personnage, en détruisant ses guitares et en chassant ses « fans ».
Ce « voyage dans l’esprit d’un fou » permet également de faire quelques critiques et commentaires sur la société. En premier lieu, évidemment, la guerre. Pink Floyd est marqué par la mort absurde de son père sur les champs de bataille, mais au delà c’est la propre histoire de Roger Waters qui transparaît, son père ayant subi la même chose (pour l’anecdote, l’album suivant, The Final Cut, présenté comme une pseudo-suite de The Wall s’intéresse à un soldat vétéran devenu le professeur de notre rock star). La guerre, dont l’absurdité et le pouvoir d’auto-destruction sont montrés avec l’image du drapeau britannique ensanglanté et tombant en morceaux, occupe une partie importante dans le début du film.
Puis l’éducation, avec bien sûr la chanson-culte, et la révolte violente des enfants, masqués et uniformisés par une même pensée (aliénation de l’homme, on y revient), broyés dans les machines, qui brise les murs, détruisent leur carcan et précipitent leur professeur dans un bûcher. A travers ces images chocs, violentes, et surtout explicites, le film fait un usage de la symbolique qui traduit le fond de la scène par une imagerie et une représentation sans concession, directe, et même « baroque », dans le sens où le spectaculaire est utilisé pour représenter parfois rien qu’un délire, un fantasme ou un état d’esprit.

La société de consommation a sa place dans la liste des critiques, avec notamment la TV, qui abrutit Pink pendant l’essentiel du film, jusqu’à ce qu’il se décide à la balancer par la fenêtre. Son seul refuge derrière son Mur, la télévision apparaît bien vite artificielle, peut-être également parce qu’elle représente un miroir déformant du monde. Dès lors, devient-elle insupportable parce qu’elle est un « trou » dans le Mur qui laisse apercevoir le reste de la société, ou bien parce qu’elle offre une vision fausse et vide de sens ? Sans doute les deux à la fois.
Le succès et la célébrité également sont un sujet du film, la pression oppressant Pink étant si insupportable, poussant les producteurs à droguer leur star pour qu’elle assure le show, qu’elle l’emmène aux confins de la folie, avec sa représentation d’un système totalitaire, très inspiré par les nazis, où les marteaux ont remplacé les croix gammées. Basculant définitivement de la réalité à la fiction, le film montre un Pink rasé, en tenue militaire, circulant dans la ville, envoyant ses troupes à la poursuite des noirs et autres « indésirables », hurlant dans son mégaphone sa haine et sa folie, provoquée selon ses dires par les « vers ». Cette scène hallucinée l’est d’autant plus avec le mélange d’animation, où une armée de marteaux marchent sur la ville, sous l’orage et les éclairs. Toute la séquence constitue en soit un climax, la folie atteignant son apogée, et sa haine pour la société des hommes éclatant au grand jour.
Le système social, l’aliénation de l’humain sont pris à parti, à travers l’éducation, la guerre et la manipulation des masses, amenant à ce délire totalitariste. Les rapports humains ainsi montrés ne semblent être que violence, exploitation des faibles, manipulation et destruction. En définitive, The Wall nous parle de la condition de l’espèce humaine, exploitée, uniformisée et conformisée, une vision définitivement pessimiste, que la fin n’aidera pas à dissiper.

Il y a une progression dans le film, qui est fait un collage de souvenirs, d’hallucinations, de délires en temps réel, de séquences d’animation et d’images presque abstraites, accompagnant la musique, qui elle même joue le rôle de fil conducteur, jusqu’à ce qu’on ne sache plus qui du film ou de la musique illustre l’autre. Plus le film avance, plus l’hallucination devient omniprésente et violente, jusqu’au tribunal, et l’explosion du Mur. Ainsi nous apparaît le film, une collection de visions psychédéliques, visuellement explicites, montrant la tempête intérieure d’un homme assis dans son fauteuil.

C’est là que réside le génie du long-métrage. Tout comme la carrière du groupe, cette oeuvre est une expérimentation, une nouvelle façon de raconter une histoire, en exacerbant le rôle des images, de la musique, de la symbolique, du découpage séquentiel et de la mise en scène, pour obtenir pour le spectateur une expérience unique, psychologique et malsaine.
Mais si l’on peut dire que The Wall met en émulsion les codes du cinéma, cela va plus loin : c’est de l’art en général qu’il tord les codes et les explose. Ce genre de projet multimédia se retrouve déjà au XIXe siècle, avec notamment L’Anneau du Nibelung de Richard Wagner, un cycle d’opéras (de quatorze heures sans entracte !) basé sur les légendes nordiques, et se déclinant également dans l’architecture, avec la construction d’un théâtre à Bayreuth, ou encore la peinture… Un concept nommé « Gesamtkunstwerk », « l’oeuvre d’art totale », qui transcende les limites de l’art pour s’étendre au-delà. The Wall est une oeuvre d’art totale moderne, dont le film n’est qu’une partie. Le concept dans son ensemble est un pari fantastique et gigantesque, à la fois spectaculaire dans son ambition et les supports qui le portent, sa richesse et sa complexité, mais également intimiste, dans cet aspect « plongée dans la pensée », et impressionnant de par son sujet psychologique halluciné et engagé, traité avec justesse, et qui donne lieu à des expérimentations et expériences visuelles et sonores hors du commun.
Pour faire suite à mon laïus sur l’Expérience que doit apporter une oeuvre d’art (voir la critique sur Blade Runner), j’ajouterai que c’est ainsi qu’elle peut atteindre cet objectif : en repoussant les frontières du support et les délimitations communément admises par l’humanité consommatrice, pour aller chercher plus loin, chercher jusqu’où l’art peut s’étendre. Car l’Art est une conquérante, qui apporte ses moments de gloire lorsqu’elle se met à explorer les possibilités encore inconnues, à tous les niveaux. Je m’emporte peut-être, mais c’est parce que je suis en admiration totale devant ce genre de projet ambitieux, à la recherche d’un nouveau langage, d’une nouvelle vision, de nouveaux horizons.
Ainsi, voilà ce que l’on peut dire sur The Wall, un chef-d’oeuvre exprimant le mieux jusqu’où l’art a la capacité et le pouvoir d’aller, un pur objet de mise en scène, de sensations et d’émotions, chargé de métaphores et de symboles, définitivement un des mes films et albums favoris, un monument artistique ayant pour sujet… un homme assis dans son fauteuil, qui regarde sa télévision.
Jester Dantès, derrière son Mur.
Liste des critiques ici.
